36 - 9 juin 1943 : Arrestation du général Delestraint
Sortie du métro La Muette, à l’angle de l’avenue Mozart
Chapitres :
L’Armée secrète et les difficultés de son chef
L’arrestation de Vidal, Fresnes

Charles Delestraint fut le supérieur de de Gaulle
Charles Delestraint, né en 1879, originaire du Pas-de-Calais, fils de comptable, saint-cyrien en 1897, admis à l'École de Guerre en 1914. Promu général en 1936, il compte parmi ses subordonnés Charles de Gaulle, avec qui il partage les idées novatrices dans l’utilisation des chars (que mettra en pratique le général Guderian en 1940).
Placé dans le cadre de réserve en 1939, il est rappelé pour commander les chars de combat de la VIIe Armée puis du Groupement Cuirassé, avec lequel il couvre le repli de deux armées et réduit la poche d'Abbeville. Il mène les combats jusqu'à Valençay, refuse la défaite et l'armistice.
Il est à nouveau cadre de réserve et se replie à Bourg-en-Bresse, dans un modeste appartement. C’est là que, début août 1942, Henri Frenay vient lui proposer de prendre la tête de l’Armée secrète. Leur origine militaire commune donne confiance à Delestraint. Il rappelle qu’il a eu de Gaulle sous ses ordres : « ’ai pour lui, pour son intelligence rapide, pour son sens de la manœuvre, beaucoup d’admiration» ; et Delestraint précise que se mettre sous les ordres de son ancien subordonné ne lui pose pas de problèmes, il demandera cependant un ordre écrit et un temps de réflexion.
La nomination de Delestraint
Au milieu de l'année 1942, les trois grands mouvements de la zone Sud non occupée reconnaissant l’autorité de Londres, Combat (Henri Frenay), Libération (Emmanuel d’Astier de la Vigerie) et Franc Tireur (Jean-Pierre Lévy), souhaitent coordonner leurs unités de combat. Henri Frenay, fort de son expérience de militaire, se propose pour en prendre le commandement mais son principal rival, d’Astier, s’y oppose, ainsi que le délégué du général de Gaulle, Jean Moulin, qui souhaite que ce poste ne soit pas occupé par une personnalité déjà engagée dans un mouvement. C’est alors que Frenay propose le nom de Charles Delestraint, proposition unanimement acceptée.
Jean Moulin et Delestraint se rencontrent à Lyon le 28 août. Le 15 octobre, la nomination du général Delestraint est entérinée à l’issue de la conférence qui réunit à Londres, Frenay, d’Astier, Brossolette et André Philip (Jean Moulin et Jean-Pierre Lévy étant bloqués en France). «J’ai des généraux à caser, puisqu’il y en a maintenant qui veulent se battre !» avait dit auparavant de Gaulle, évoquant la candidature d’Henri Frenay, qui n’était que capitaine en juin 1940.
La prise effective de commandement périlleux ne se fait que le 11 novembre 1942. De Gaulle lui écrit aussitôt : «Personne n’était plus qualifié que vous pour entreprendre cela. Et c’est le moment ! Je vous embrasse, mon général, nous referons l’armée française».
Son secrétaire est François-Yves Guillin ; le chef du 2e bureau de l'AS est Joseph Gastaldo ; Raymond et Lucie Aubrac font partie de l’état-major.
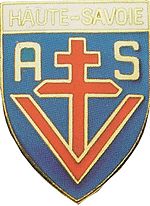
L’Armée secrète
Les missions de l’AS : organiser les actions en fonction du Jour J, neutraliser les moyens industriels ; détruire les moyens de transport et de communication le Jour J, multiplier les actes de guérilla après le Jour J pour ralentir les déplacements.
La réunion du 27 novembre 1942 à Collonges-au-Mont-d’Or amorce l’union des groupes francs de la zone Sud, à la suite de quoi Delestraint passe la ligne de démarcation pour prendre contact avec les mouvements majeurs de la zone Nord : ceux de la Libération (CDDL), l'Organisation civile et militaire (OCM), le Front national du PCF et Libération-Nord.
Reste à Delestraint de se faire connaître auprès des autorités militaires britanniques, ce qui est fait lors de son déplacement à Londres du 12 février au 23 mars 1943.

Armée secrète, bataillon de Savoie en 1944
Les difficultés du chef de l’AS, alias «Vidal»
Delestraint est dorénavant «Vidal». Un pseudonyme de résistant, certes, mais il reste un militaire de carrière de 55 ans, pour qui la clandestinité et les méthodes de combat de type guérilla sont inconnues ; il doit faire face aux critiques des chefs résistants.
Par ailleurs, la consigne claire de de Gaulle est d’organiser l’action et le renseignement pour le débarquement, la doctrine du Jour J, ce à quoi sont opposés Charles Tillon, chef des FTPF communistes, et quelques autres, partisans d’une multiplicité d’actions.
Delestraint, avec l’approbation de de Gaulle, veut mettre en place des maquis immobiles, pour faciliter les parachutages d’armes et de munitions et fixer les forces allemandes au moment du débarquement. Ces maquis ont le grave défaut d’être facilement repérables par l’ennemi, les maquis du plateau des Glières et du Vercors, en paieront un lourd tribut.
Des chefs sont arrêtés : Février 1943, les hommes de Hugo Geissler, de la Gestapo de Vichy, arrêtent à Lyon le capitaine Claudius Billon, chef de l'AS de la région (onze départements), et son adjoint. A Saint-Étienne, toujours en février, le chef de l'AS Loire et ses compagnons sont arrêtés par les mêmes. Le 10 février, au Puy-en-Velay, c'est le même sort qui frappe l'état-major de l'AS Haute-Loire.

Manque de discrétion : en avril, Delestraint repart une nouvelle fois à Paris où il arrive le 11 avril. Le général a du mal à endosser les habits du résistant, ceux de la discrétion, il a ses vrais papiers d’identité sur lui. Jean Moulin déplore les risques qu’il prend, accomplissant seul son travail alors qu'il devrait être mieux secondé.
L’arrestation de Vidal
Le 9 juin, il est censé avoir rendez-vous avec «Didot» (René Hardy). Une voiture s’arrête d’où descend un jeune homme lui disant que le lieu de rendez-vous a changé. Il ne flaire pas le piège, monte dans la voiture ; le pseudo-résistant est un agent de l’Abwehr, un Alsacien nommé Moog, dont la «carrière» sera évoquée ci-après. «Le général est apparu à la station de métro La Muette à 9 heures et 2 minutes. Dans la voiture où nous l'avons fait monter (il se croyait avec des Résistants), il nous a dit : "J'ai un autre rendez-vous au métro Pompe à 10 heures», selon le rapport des agents français de l’Abwehr présents, René Saumande et le Jean Multon.
Cette dernière information permet aux Allemands de repérer le chef de renseignements de l’AS, le capitaine Gastaldo et son adjoint, Jean-Louis Théobald.
Le Général Delestraint est emmené rue des Saussaies, derrière la place Beauvau, dans un des bâtiments du ministère de l’Intérieur réquisitionné par la Gestapo (cf. 05) ; Gastaldo et Théobald arrivent à leur tour, ils n’ont pas échappé au piège, les policiers allemands les ont appréhendés à leur tour à la station La Pompe. Moog reste, le capitaine Kramer et Saumande repartent bientôt - ils ont fait leur boulot, leur rôle est terminé -; Multon est toujours en poste à l'intérieur de la station du métro La Muette.
Une heure s'écoule, les trois prisonniers sont transférés au 84 Avenue Foch où ils seront interrogés par les services de l’Hauptsturmführer Kieffer. Les préposés à la «question» sont l’Oberscharführer Misselwitz et l’Untersturmführer Gutgsell.
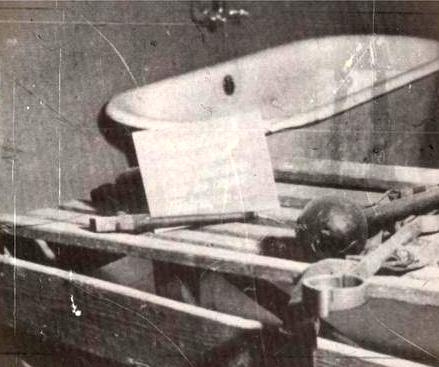
L'interrogatoire va durer 50 heures consécutives !
Delestraint se contente de reconnaître qu'il est le chef de l'Armée Secrète, qu'il est envoyé de Londres par le Général de Gaulle. C’est tout. Il ne peut nier son identité véritable, ayant ses propres papiers sur lui. Les Allemands connaissent aussi l'adresse parisienne du Général, 5 Boulevard Murat. L'après-midi même, ils interrogent la concierge, madame Flore Sicard, sans résultats.
Fresnes
Les prisonniers sont ensuite conduits à Fresnes en fourgon cellulaire. C’est au cours d’un autre transfert où Théobald et Deslestraint sont enchaînés l’un à l’autre que le Général confie alors ses soupçons sur la culpabilité de Didot (René Hardy) : avoir un rendez-vous avec un homme qui n'y vient pas, mais trouver à sa place la police allemande...

Delestraint fera ainsi plusieurs allers et retours entre la prison et l’avenue Foch pour interrogatoires. A l’exception de quelques semaines où il est incarcéré «villa Bömelburg» du nom du chef de la Gestapo en France, à Neuilly. Là, le 10 ou 12 Juillet 1943, il est mis en présence de Jean Moulin gisant sur une civière, "le visage en bouillie, recouvert de pansements".
-"Reconnaissez-vous Max (pseudonyme de Jean Moulin) en cet homme ?"
-"Comment voulez-vous que je reconnaisse cet homme dans l'état où il se trouve ?"
Nacht und Nebel
Fin novembre 1943, le général et une dizaine d’autres membres de l’AS comparaissent devant un tribunal constitué à Fresnes ; ils sont "Nacht und Nebel" (Nuit et Brouillard), ces inculpés qui ne doivent plus avoir aucun contact avec leurs familles ou leur pays d'origine, et qui doivent comparaître ensuite devant un «Tribunal du Peuple» en Allemagne où la mort est le verdict probable.
Début Mars 1944, Delestraint, accompagné de Gastaldo, quitte Fresnes pour Compiègne, lieu d'aiguillage avant les camps. De Compiègne, un convoi l’emmène au Struthof où il sera détenu pendant six mois, avant Dachau. Theobald, quant à lui, a quitté la prison en Janvier et s'est évadé du train qui l'emmenait à Buchenwald

A Dachau, Delestraint sera vite considéré comme le Chef de tous les Français.
19 avril 1945
Avril 1945, Kaltenbrunner, chef de la Sûreté, bras droit de Himmler, donne l’ordre d’exécuter Delestraint. Ce matin du Jeudi 19 avril 1945, un sous-officier vient chercher le Général alors qu'il sert la messe. Le S.S. lui dit de se préparer parce qu'il appartient à un convoi en partance.
Il est accompagné, soi-disant, pour les formalités d'élargissement. Vers 11 heures, au niveau de la "butte de tir" près des crématoires, le S.S. Boomgaerts s'approche à deux mètres derrière le général et lui tire une balle dans la nuque. Le général aurait pu parler pour demander le coup de grâce. Le S.S. l’achève d’une balle dans la bouche.
Ordre est donné d’incinérer immédiatement le corps, avec les vêtements et tous les objets personnels de la victime.
S’il n’y eut pas de témoin oculaire de l’exécution, beaucoup virent le général se diriger vers la butte et entendirent les détonations ; parmi eux, l’accordéoniste André Verchuren, arrêté sur dénonciation pour avoir aidé à cacher des aviateurs alliés.

Robert Moog, le traître absolu
Immonde, crapule, redoutable, abject, traître absolu, quelques-uns des attributs accolés au nom de ce sinistre personnage qui fit des ravages dans les rangs de la Résistance.
«Le loup le plus dangereux de l'abominable troupeau sévissant en France» A. Devigny.
Né en 1915 à Paris d’une mère blanchisseuse et d’un père, tailleur d'habits ; il est issu d’une famille alsacienne, parfaitement bilingue.
Peu d’informations le concernant avant l’Occupation sinon qu’il a été employé de commerce et qu’il s’est marié à Paris en 1936. Des soupçons cependant : Moog aurait été approché et formé en Allemagne avant la guerre pour devenir espion, agent de pénétration ; il avait toutes les dispositions : intelligent et rusé, entreprenant, sans scrupules, manipulateur et un beau garçon blond aux yeux bleus !
Une chose est certaine : il adhère totalement aux thèses nazies et est prêt à toutes les bassesses pour le prouver.
C’est une recrue du capitaine Eugen Kramer, de l’Abwehr (services de renseignements), qui affirme l’avoir employé depuis 1942. Kramer avait constitué un réseau d’agents dont le «matricule» commençait par K. Moog était K30, il avait été recruté par K4, René Saumande, membre du Parti populaire français de Doriot.
La poudrerie de Toulouse et la blanchisserie de Lyon
25 janvier 1943, Moog se fait embaucher comme contremaître dans la poudrerie de Toulouse - les poudreries font naturellement partie des cibles privilégiées de la Résistance. Se faisant habilement passer pour sympathisant, il approche François Hitter, membre du réseau Gilbert, le réseau du colonel Georges Groussard. On projette un sabotage ; Moog se propose pour en être l’auteur ; le réseau est infiltré, les membres arrêtés.

La Gestapo décrypte les informations glanées par Moog qui permettent d’identifier l’agent de liaison du réseau entre Toulouse et Lyon. Fort de ces informations, Moog prend le train pour Lyon, repère l’agent de liaison, le fait arrêter et prend sa place et son courrier.
La Gestapo de Lyon peut ainsi tendre une souricière autour de la boîte à lettres lyonnaise du réseau, la blanchisserie du 4, rue Béchevelin.
15 avril 1943, le capitaine Bulard (photo) vient y retirer son courrier, flaire le piège et tente de s’enfuir. Moog l’abat de deux coups de feu sous les yeux de Klaus Barbie. Moog quitte alors l’Abwehr pour la Gestapo lyonnaise sous les ordres de Barbie.
Usant de son charme, il réussit à retourner Edmée Deletraz, agent de liaison. Est-elle à l’origine de l’arrestation d’André Devigny, autre membre éminent du réseau Gilbert, ou encore de Berty Albrecht, fondatrice de Combat, à Mâcon, le 28 mai 1943, et qui mourra des suites de ses tortures ? Moog est présent lors de ces deux arrestations, « toujours là, prêt à aider, à conseiller, montrant en permanence le visage d'un patriote compétent et empressé», selon les propres dires de Devigny.
Suivront Delestraint, le commandant Faye, du réseau Alliance, en septembre 1943,et les arrestations de Caluire car, selon l’écrivain Jean-Paul Picaper, «C’est à lui (Moog), probablement, que Barbie dut son titre de gloire : l’arrestation de Jean Moulin».
Quel terrible tableau de chasse !
Moog se lance en février 1944 dans des opérations contre les maquis du Bugey. Puis il disparaît. Qu’est-il devenu ? Mystère. Un accident d’avion en Allemagne en 1944, un accident de voiture en 1945 ? Et, pourtant, un document prouve qu’il a divorcé de sa femme le 21 décembre 1948 !
Les deux autres gestapistes présents au métro La Muette

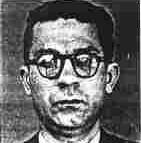
René Saumande : condamné à mort le 6 juillet 1951, fusillé l’année suivante. Il a participé, entre autres crimes, au démantèlement du réseau Alliance.
Jean Multon (1908-1946), alias «Lunel»
Contrairement à Moog, Multon est un transfuge de la Résistance ; l’agent d'assurances rejoint l'Armée des Volontaires, puis Combat à Marseille, où il devient «l'homme de confiance», du chef régional, Maurice Chevance.
Il est arrêté le 27 avril 1943 par la Gestapo. "Lunel" parle sans qu'aucune contrainte physique n'ait été exercée contre lui et accepte de collaborer.
Premières victimes : Maurice Chevance, qui réussit à s’enfuir malgré une jambe fracturée, puis Pierre Bernheim, membre du NAP (Noyautage des Administrations Publiques),
Multon rejoint Lyon le 24 mai ; il se met immédiatement au service de Klaus Barbie et fait équipe avec Robert Moog, agent K30.
Suivront les arrestations de Charles Delestraint, Berty Albrecht, Roger Morange…
Lorsque le vent tourne, Multon passe en Espagne en avril 1944, puis au Maroc ; il se fait incorporer dans l'Armée de Libération du général de Lattre et tente de brouiller les pistes avant de se faire arrêter le 7 février 1945. Il est fusillé au fort de Montrouge le 10 septembre 1946.
La funeste conséquence de l’arrestation de Delestraint
L’arrestation du général va avoir une conséquence funeste. Jean Moulin doit, dans l’urgence, lui trouver un remplaçant. Se sachant traqué par la Gestapo, «Je suis recherché tout à la fois par Vichy et par la Gestapo qui, en partie grâce aux méthodes de certains éléments des mouvements, n’ignore rien de mon identité ni de mes activités», il prend quand même le risque de se rendre à Lyon. Le 21 juin 1943, c’est la réunion de Caluire et son arrestation. Un drame auquel sont mêlés les noms de Robert Moog, Jean Multon, Edmée Deletraz, René Hardy et Klaus Barbie.

René Hardy ; Edmée Deletraz et Klaus Barbie

Caluire, 21 juin 1943,
La maison du docteur Dugoujon
Le général Delestraint sera remplacé par le général Pierre Dejussieu-Pontcarral, un officier mieux préparé à ce type de lutte.
Le 29 décembre 1943, la fusion entre l’AS et les FTP, donne naissance aux FFI, sous l'autorité du général Kœnig le 23 mars 1944.
De 15.000 en septembre 1942, les effectifs de l’AS sont passés à 100.000 début 1944, avec à son actif des zones interdites à l’occupant, les blocages des transports, les sabotages et la désorganisation de l’appareil vichyste.
Pour en savoir plus :
http://charles.delestraint.free.fr/p5.htm
Jean-Paul Picaper : Ces nazis qui ont échappé à la corde (éd. de l’Archipel)
Jean Lacouture : De Gaulle, tome 1, le Rebelle (Seuil)
Henri Frenay : La Nuit finira (Robert Laffont)





