M3 : 1807 : pont d'Austerlitz
Pour relier le faubourg Saint-Antoine au jardin des Plantes, le Premier Consul en décide la construction en 1801, en même temps qu’une nouvelle version du pont de la Cité (reliant cette île à l’île Saint-Louis) et le pont des Arts. La première pierre est posée en 1802 et sa mise en service en 1807. C’est un ouvrage à péage de cinq arches en fonte de 32 m d'ouverture, s'appuyant sur quatre piles et deux culées en maçonnerie.
Entre 1814 et 1830, le nom est changé en « pont du Jardin-du-Roi » pour ne pas indisposer les nouveaux alliés prussiens et russes. Le pont actuel date de 1855 ; il est décoré de motifs incluant les noms des principaux officiers tués à la bataille d'Austerlitz.
La bataille d’Austerlitz, la « bataille des Trois Empereurs »
Aujourd’hui Slavkov u Brna, en République tchèque.
Lundi 2 décembre 1805 (11 frimaire an XIV), entre Brünn et Austerlitz.
En août 1805, la flotte de l’amiral Villeneuve est bloquée à Cadix par Nelson (2 mois avant le désastre de Trafalgar) ; l’invasion de l’Angleterre n’est plus à l’ordre du jour.
Un an auparavant, une troisième coalition s’était formée à l’instigation de William Pitt, entre l’Autriche, la Russie, la Suède et l’Angleterre. Les Anglais se contentent de financer.
La Grande armée tourne le dos à la Manche lorsque Napoléon apprend que la Bavière, alliée de la France, est envahie par les troupes autrichiennes du général Mack. 150 000 fantassins, 40 000 cavaliers et 350 canons gagnent l’Allemagne à marche forcée (jusqu’à 40 km par jour). L’objectif est d’atteindre Vienne avant que les Russes ne fassent la jonction avec les Autrichiens.
En trois semaines, l’armée est réorganisée aux portes de l’Autriche. Le 20 octobre 1805, la Grande Armée défait le général Mack à Ulm. La route de Vienne est ouverte. Le 13 novembre, Murat et Lannes prennent Vienne sans coup de feu.
Austerlitz : le piège de Napoléon face aux austro-russes en surnombre
Face aux armées Austro-Russes en nette supériorité numérique, Napoléon va multiplier les ruses pour convaincre les adversaires qu’il refuse la bataille : organiser des replis, refuser des escarmouches, battre en retraite. Le vieux Koutouzov n'est pas dupe mais les jeunes généraux russes, nobles peu expérimentés ayant acheté leurs charges, veulent briller devant le Tsar et foncent dans le piège, sans attendre les renforts.
Napoléon envoie Savary, son aide de camp, faire des propositions de paix. Il apparaît même « la figure sale et mal accoutré » à Dolgoroukov, l’envoyé du tsar, plus habitué aux bals à Saint-Pétersbourg qu’aux bivouacs. « Napoléon tremblait de peur. J’ai vu l’armée française à la veille de sa perte. Notre avant-garde suffirait à l’écraser », déclare-t-il à son retour.
Le piège fonctionne. Le tsar décide de ne pas attendre l’armée de l’archiduc Charles, partie d’Italie. Il choisit le général autrichien Weyrother : « J’emploierai contre Bonaparte la même manœuvre qui lui avait servi à battre les Autrichiens à Castiglione. La victoire est certaine ».
La bataille
Le 2 décembre, à 4 heures du matin, les 4 colonnes alliées quittent le plateau de Pratzen et marchent sur le flanc droit des Français. À 7 heures, Kienmayer envoie son avant-garde à l’assaut de Telnitz, mais elle est repoussée. À 8 heures, Kienmayer a perdu l’ensemble de ses troupes dans une troisième attaque vaine, le général Langeron perd du temps et Dokhtourov arrête sa colonne. Tout le plan de Weyrother est compromis.
A 9 heures, Dokhtourov et Langeron finissent par prendre Telnitz et Sokolnitz. Mais Napoléon vient d’attaquer ! La surprise est totale, les colonnes russes sont assaillies de flanc. Le combat, d’une rare violence, ne dure que quelques minutes. Les Français sont maîtres du plateau de Pratzen. Soult installe ses canons.
Koutouzov envoie toutes ses réserves, y compris la Garde russe, pour reconquérir le plateau. Echec ; la bataille est perdue pour les Alliés : l’armée est coupée en deux.
14 heures, Koutouzov étudie seul les voies de retraite, le tsar et tout l’état-major ayant déjà fui une heure plus tôt.
À 15 heures 30, n’écoutant plus leurs officiers, 20 000 Russes fuient en désordre et espèrent échapper à l’encerclement en traversant les marais et les étangs gelés. Mais quand l’artillerie française tire pour briser la glace, les hommes et leur matériel s'enfoncent dans l'eau. « Il faut avoir été témoin de la confusion qui régnait dans notre retraite (ou plutôt de notre fuite) pour s’en faire une idée. Il ne restait pas deux hommes d’une même compagnie ensemble […] les soldats jetaient leurs fusils et n’écoutaient plus leurs officiers, ni leurs généraux ; ceux-ci criaient, fort inutilement, et couraient comme eux. »
Les Français comptent 1 537 morts, 6 943 blessés et 573 prisonniers. Les alliés comptent 16 000 morts et blessés et 11 000 prisonniers. Les 185 canons pris sont en partie fondus pour constituer une partie de la colonne Vendôme.
Conséquences politiques
Le 4 décembre, Napoléon et François II se réunissent. Ils conviennent d’un armistice et des conditions de paix autour d’un brasier. « Les Anglais sont des marchands de chair humaine, ils payent les autres pour se battre à leur place » s’exclame l'empereur autrichien. Après une heure d’entrevue, Napoléon demande : « Votre Majesté me promet donc de ne me plus faire la guerre ? » et François II répond : « Je le jure et je tiendrai parole ».
Le 26 décembre, l’Autriche signe le traité de Presbourg. Elle perd 4 millions de sujets et la Vénétie. Elle doit donner le Tyrol, au profit de la Bavière et du Wurtemberg. François II renonce à son titre d’empereur germanique et devient François Ier d'Autriche ; c’en est fini du saint empire romain germanique. Enfin, l’Autriche paye une indemnité de 1/7 de son revenu national.
« Soldats, je suis content de vous ….
Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous ramènerai en France ; là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire, “J'étais à la bataille d'Austerlitz”, pour que l'on réponde, “Voilà un brave” »
Source :
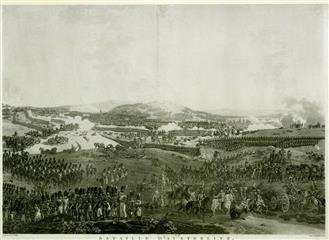

Muller – Bataille d’Austerlitz (gallica.bnf.fr)
